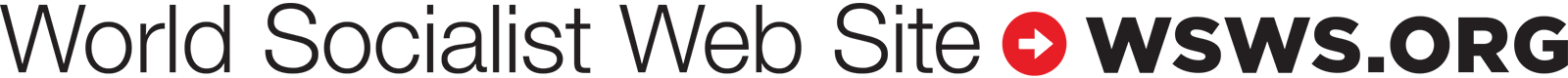En 1923, une profonde crise économique et politique a ébranlé la société allemande jusque dans ses fondements. À l'occasion de son centenaire, une demi-douzaine de nouveaux livres ont été publiés sur cette 'année au bord du précipice', écrits par des historiens et des journalistes de renom tels que Volker Ullrich et Peter Longerich. Dans les conditions actuelles d'inflation élevée, de conflits de classe féroces et d'escalade des guerres, les événements de cette époque sont à nouveau d'une brûlante actualité.
Ces nouveaux livres suivent tous la même trame: en raison de l'hyperinflation, de l'appauvrissement et de la radicalisation, la république démocratique a été mise en danger par des tentatives de renversement de gauche et de droite et a finalement été sauvée par l'intervention courageuse de ceux qui détenaient les responsabilités politiques et militaires.
Si l'on étudie les événements de plus près - et l'on peut trouver dans les livres de bonnes informations à ce sujet - une image complètement différente apparaît. La crise sociale a fait voler en éclats la façade démocratique de la République de Weimar et a montré ce qu'elle était réellement: une couverture pour le maintien de la dictature des anciennes élites de l'Empire allemand - les grands industriels, les grands propriétaires terriens et les militaires.
Le président du Reich, Friedrich Ebert, un social-démocrate, a 'sauvé' la république en déchaînant la Reichswehr (armée) contre les travailleurs insurgés, en déposant par la force les gouvernements sociaux-démocrates de gauche en Thuringe et en Saxe, et en transférant le pouvoir exécutif du Reich au commandant suprême de la Reichswehr, le général von Seeckt, établissant ainsi de fait une dictature militaire. L'instauration d'une telle dictature était également l'objectif poursuivi par Hitler et le général Ludendorff en novembre 1923, lorsqu'ils ont organisé un coup d'État à Munich.
Après que le gouvernement de Gustav Stresemann eut réussi à maîtriser l'inflation par une réforme monétaire à la fin de l'année et que l'économie se fut quelque peu redressée grâce à l'aide américaine, von Seeckt rendit le pouvoir exécutif au gouvernement civil. Mais ce ne fut qu'un intermède. Lorsque la crise majeure suivante frappa l'Allemagne avec le krach de Wall Street en 1929, la façade démocratique s'effondra définitivement.
Pendant deux ans, Brüning, politicien du parti du centre, a gouverné avec des décrets d'urgence, qui étaient approuvés par le président du Reich. Face à l'aggravation de la crise, la classe dirigeante ne se contenta plus d'un transfert temporaire du pouvoir exécutif à l'armée, mais nomma Adolf Hitler chancelier et lui confèra des pouvoirs de dictateur. L'année 1923 s'est révélée être un prélude à l'instauration de la dictature nazie en 1933.
Il y avait une alternative. Si la classe ouvrière s'était emparée du pouvoir en 1923, avait privé les anciennes élites de leurs droits et les avait expropriées, l'histoire de l'Allemagne et du monde aurait suivi un cours différent. L'occasion de le faire existait. L'hyperinflation - à son apogée, un dollar valait 6.000 milliards de marks - a polarisé la société et radicalisé la classe ouvrière et les classes moyennes. Elle a plongé les travailleurs dans la misère et anéanti les économies de la petite bourgeoisie, tandis que les profiteurs de la crise, comme le grand industriel Hugo Stinnes, ont amassé des fortunes colossales.
L'ambiance était révolutionnaire. Le parti communiste se développa aux dépens des sociaux-démocrates. Le nombre de ses membres atteignit 300.000 et il bénéficiait du soutien de la majorité des travailleurs à l'esprit socialiste. Mais sa direction n'était pas à la hauteur de la tâche. Elle s'adaptait parfois aux humeurs nationalistes et tarda à comprendre la situation révolutionnaire. Ce n'est qu'au cours de l'été, lorsqu'une grève générale contraignit le gouvernement de Wilhelm Cuno à démissionner, qu'elle commença à planifier un soulèvement en étroite concertation avec l'Internationale communiste à Moscou.
Mais lorsque les sociaux-démocrates de gauche se sont prononcés contre le soulèvement qui avait été préparé lors d'un congrès du comité d'entreprise à Chemnitz le 21 octobre, le KPD l'a annulé à la dernière minute. Le soulèvement n'éclata qu'à Hambourg, où il fut réprimé en trois jours.
Les conséquences de l'échec du soulèvement socialiste, l''Octobre allemand', dépassa largement les frontières de l'Allemagne. En Union soviétique, où la classe ouvrière avait suivi avec espoir les progrès de la révolution allemande, son échec renforça la bureaucratie conservatrice. Le même mois, l'Opposition de gauche fut fondée et repris le combat contre la bureaucratie.
Les 'leçons d'octobre' ont joué un rôle important dans la lutte entre la bureaucratie et l'opposition. Lorsque Trotski tira les leçons de la défaite allemande dans une brochure portant ce titre, il fut violemment attaqué par Staline et ses alliés. Dix ans plus tard, les politiques désastreuses imposées par Staline au KPD ouvriront la voie à l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Les nouveaux livres sur 1923 ignorent largement l'importance de l''Octobre allemand' et de son échec. Ils l'écartent en quelques lignes ou le décrivent comme une tentative de coup d'État sans espoir, menée par un petit groupe qui n'avait aucun soutien parmi les masses.
Même Volker Ullrich, qui consacre un chapitre entier à l''Octobre allemand' dans son livre, par ailleurs très lisible, Allemagne 1923: L'année de l'abîme, conclut celui-ci par le rejet des plans d'insurrection par les représentants du SPD à Chemnitz: 'il devint clair que tant le Comintern que les communistes allemands avaient mal évalué l'état d'esprit de la classe ouvrière'. Le siège du KPD tire alors 'la seule conséquence possible' et abandonne le plan d'insurrection.
L'article suivant, basé sur une conférence donnée durant l'été 2007 et publiée pour la première fois sur le World Socialist Web Site le 22 octobre 2008, montre que ce n'est pas vrai. L''Octobre allemand' a échoué non pas à cause de l''humeur des masses', qui était révolutionnaire à tous égards, mais à cause des erreurs politiques et des hésitations du KPD et de l'Internationale communiste sous la direction de Zinoviev, qui était à l'époque étroitement allié à Staline.
L'article montre que deux conditions doivent être réunies pour qu'une révolution socialiste réussisse : une situation objectivement révolutionnaire qui ne laisse à la classe ouvrière d'autre issue que le renversement du capitalisme, et une direction révolutionnaire ancrée dans la classe ouvrière et à la hauteur de ses tâches.
* * *
En 1923, une situation révolutionnaire extrêmement favorable se développa en Allemagne. Le Parti communiste allemand (KPD), en étroite collaboration avec l'Internationale communiste (Comintern), prépara une insurrection et l'annula à la dernière minute, le 21 octobre. Trotsky parlera plus tard d'une 'démonstration classique de la façon dont il est possible de manquer une situation révolutionnaire parfaitement exceptionnelle d'une importance historique mondiale' [1].
La défaite allemande de 1923 fut lourde de conséquences. Elle a permis à la bourgeoisie allemande de consolider son pouvoir et de stabiliser la situation pendant six ans. Lorsque la crise majeure suivante a éclaté en 1929, la classe ouvrière a été complètement désorientée par la direction stalinienne du KPD. Cela a conduit directement aux événements fatidiques qui ont abouti à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Sur le plan international, la défaite de l'Octobre allemand a perpétué l'isolement de l'Union soviétique et a donc constitué un facteur psychologique et matériel important qui a renforcé le développement de la bureaucratie stalinienne.
La conférence d'aujourd'hui se concentrera sur les leçons stratégiques et tactiques de l'Octobre allemand, leçons qui sont rapidement devenues un sujet de discorde entre l'Opposition de gauche et la Troïka dirigée par Staline, Zinoviev et Kamenev. Avant d'aborder ces questions, il est nécessaire de faire le point sur les événements de 1923.
L’Allemagne en 1923
Toutes les questions fondamentales qui avaient poussé l'impérialisme allemand à entrer dans la Première Guerre mondiale en 1914 - l'accès aux marchés et aux matières premières pour son industrie dynamique, la réorganisation de l'Europe sous son hégémonie – demeuraient irrésolues en 1923. En plus d'avoir perdu la guerre à un coût énorme en vies humaines et en ressources matérielles, l'Allemagne a été obligée par le traité de Versailles de payer d'immenses réparations à son grand rival, la France, et à d'autres puissances impérialistes.
L'immédiat après-guerre, de 1918 à 1921, se caractérisait par une série de bouleversements révolutionnaires qui ne purent être réprimés que par les efforts conjoints de la social-démocratie et des forces paramilitaires de droite. Le 11 janvier 1923, les troupes françaises et belges occupèrent la Ruhr et relancèrent la crise politique et sociale en Allemagne.
Le gouvernement français justifia l'occupation militaire du cœur de l'industrie sidérurgique et charbonnière allemande en affirmant que l'Allemagne n'avait pas respecté ses obligations en matière de réparations de guerre. Le gouvernement allemand, un régime d'extrême-droite dirigé par l'industriel Wilhelm Cuno et toléré par le parti social-démocrate (SPD), a réagi en appelant à la résistance passive. Dans la pratique, cela signifiait que les autorités locales et les entreprises de la Ruhr boycottaient les forces d'occupation. Le gouvernement continuait à payer les salaires de l'administration locale et offrait des subventions aux barons du charbon et de l'acier pour compenser leurs pertes.
Le résultat de ces énormes dépenses et de l'absence du charbon et de l'acier dont la Ruhr avait un besoin urgent a été l'effondrement complet de la monnaie allemande. Le mark, déjà fortement gonflé, s'échangeait à 21.000 marks pour un dollar américain au début de l'année. À la fin de l'année, lorsque l'inflation a atteint son apogée, le taux était de près de 6.000 milliards de marks pour un dollar - un chiffre avec 12 zéros.
L'impact social et politique de cette hyperinflation a été explosif. Elle a polarisé la société allemande comme jamais auparavant. Pour les travailleurs, l'inflation mettait leur vie en danger. Lorsqu'ils percevaient leur salaire à la fin de la semaine, celui-ci valait à peine le papier sur lequel les sommes énormes étaient imprimées. Les épouses attendaient le soir à la porte de l'usine pour se précipiter dans le magasin le plus proche et acheter quelque chose avant que l'argent ne perde sa valeur le lendemain.
Un exemple parmi d'autres: Un œuf coûte 300 marks le 3 février. Le 5 août, il coûtait 12.000 marks et trois jours plus tard, 30.000 marks. Bien que les salaires aient été adaptés à l'inflation, le salaire moyen mesuré en dollars a chuté de 50 pour cent en l'espace de six mois. Simultanément, le nombre de chômeurs explosa, passant de moins de 100.000 au début de l'année à 3,5 millions de chômeurs et 2,3 millions de travailleurs à temps partiel à la fin de l'année.
Mais les travailleurs ne furent pas les seuls à être ruinés par l'hyperinflation. Ceux qui vivaient d'une pension ont perdu tout moyen de subsistance. Ceux qui avaient économisé un peu d'argent ont tout perdu du jour au lendemain. Pour survivre, beaucoup ont dû vendre leur maison, leurs bijoux et tout ce qu'ils avaient économisé au cours de leur vie, pour découvrir le lendemain que les revenus n'avaient plus aucune valeur.
Arthur Rosenberg, qui a écrit la première histoire de la République de Weimar faisant autorité en 1928, déclarait : 'L'expropriation systématique des classes moyennes allemandes, non pas par un gouvernement socialiste, mais par un État bourgeois voué à la défense de la propriété privée, a été l'un des plus grands vols de l'histoire mondiale' [2].
De l'autre côté du fossé social, il y avait un groupe de spéculateurs, de profiteurs et d'industriels qui ont fait fortune grâce à l'inflation. Quiconque avait accès à des devises étrangères ou à de l'or pouvait exporter des marchandises allemandes à l'étranger et engranger de superprofits grâce aux bas salaires. Telles étaient les forces qui se trouvaient derrière le gouvernement Cuno. Le plus célèbre d'entre eux est Hugo Stinnes, qui a acheté 1.300 usines et s'est enrichi de plusieurs milliards au cours de cette période. Il était également un important opérateur politique dans les coulisses.
La polarisation sociale et l'effondrement des classes moyennes ont entraîné une forte polarisation politique.
Le SPD perdit rapidement tant ses membres que ses électeurs et se désintégra. Depuis le renversement du Kaiser par la révolution de novembre 1918, le SPD avait été le principal pilier du régime bourgeois en Allemagne. En 1918, il s'était allié au haut commandement militaire et aux Freikorps, une organisation paramilitaire de droite, pour réprimer la révolution prolétarienne et assassiner ses principaux dirigeants, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht.
Le SPD était le seul parti en Allemagne à défendre inconditionnellement la République de Weimar. Tous les autres partis bourgeois auraient préféré une forme de gouvernement plus autoritaire. Friedrich Ebert, un dirigeant du SPD, a été le premier président de la République de Weimar. Il a occupé la fonction présidentielle jusqu'à sa mort en février 1925, c'est-à-dire pendant toute la période dont il est question dans cette conférence.
Le rôle contre-révolutionnaire du SPD rebutait de nombreux travailleurs et les amena à rejoindre le parti communiste, le KPD. Mais au début de l'année 1923, les syndicats et les couches de travailleurs les plus conservateurs soutenaient encore le SPD. Avec l'impact de l'inflation, la situation changea rapidement.
L'historien Rosenberg, membre éminent du KPD en 1923 (il a ensuite rejoint le SPD), écrivit: 'Au cours de l'année 1923, le SPD n'a cessé de perdre de sa force... Les syndicats en particulier, qui avaient toujours été le principal pilier de l'influence du SPD, étaient en pleine désintégration... Des millions de travailleurs allemands ne voulaient plus entendre parler des vieilles tactiques syndicales et ont quitté les associations. ... La désintégration des syndicats était synonyme de paralysie du SPD.' [3]
Alors que le SPD se désintégrait, les travailleurs sociaux-démocrates écoutaient attentivement ce que les communistes avaient à dire. Au sein du SPD, une aile gauche se développait, prête à collaborer avec le KPD. Comme nous le verrons, des gouvernements de coalition entre le SPD de gauche et le KPD se sont formés en Saxe et en Thuringe pendant une courte période en octobre. Alors que le nombre de membres du SPD diminuait, l'influence du KPD s'accru. Le nombre de ses membres passa de 225.000 à 295.000 en l'espace d'un an.
Il n'y a pas eu d'élections nationales entre 1920 et 1924, de sorte qu'il n'existe pas de chiffres fiables sur le soutien électoral du KPD. Toutefois, une élection organisée dans le petit État rural de Mecklenburg-Strelitz donne une indication. En 1920, le SPD obtient 23.000 voix et le SPD indépendant (dont la majorité rejoindra plus tard le KPD) 2.000 voix. Le KPD ne se présente pas. En 1923, le SPD et le KPD obtiennent tous deux environ 11.000 voix. Dans la Sarre, région minière auparavant dominée par le catholicisme, le KPD passe de 14.000 à 39.000 voix entre 1922 et 1924.
Au sein des syndicats, l'influence des communistes s'accru également au détriment du SPD. Lors de l'élection des délégués au congrès du syndicat allemand de la métallurgie à Berlin, le KPD dépassa largement le SPD. Il obtint 54.000 voix, contre 22.000 pour le SPD, soit moins de la moitié du KPD. Selon un dirigeant du KPD, en juin, le parti comptait 500 factions au sein du syndicat de 1,6 million d'adhérents. Quelque 720.000 métallurgistes soutenaient les communistes. L'historien ouest-allemand Hermann Weber conclut dans son livre sur l'histoire du KPD: 'L'année 1923 a montré une influence croissante du KPD, qui avait probablement derrière lui la majorité des travailleurs orientés vers le socialisme'. [4]
Le KPD avant 1923
En 1923, le KPD était tout sauf un parti unifié. Il n'avait que quatre ans d'existence, mais il avait déjà connu des événements tumultueux, plusieurs changements de direction, des scissions et des fusions, et il était affecté par d'intenses divisions internes.
Son dirigeant théorique et politique le plus remarquable était sans aucun doute Rosa Luxemburg, qui avait été assassinée deux semaines seulement après la fondation du parti - une perte irréparable. Luxemburg était une révolutionnaire d'un courage et d'une intégrité énormes. Ses écrits sur le révisionnisme et sa lutte contre le glissement à droite de la social-démocratie allemande - qu'elle a perçue plus tôt et plus nettement que Lénine - font partie des meilleurs écrits de la littérature marxiste.
Mais comme Trotsky - et pendant bien plus longtemps que lui - Luxemburg n'a pas tiré les conclusions organisationnelles nettes que Lénine a tirées de sa compréhension du révisionnisme. Même après le 4 août 1914, lorsqu'elle a formé le Gruppe Internationale, plus tard appelé Spartakusbund, Luxemburg n'a pas formellement rompu avec le SPD. Son slogan était le suivant: 'Ne quittez pas le parti, changez le cours du parti'.
En 1915, le Spartakusbund rejeta l'appel de Lénine à la création d'une nouvelle internationale lors de la conférence de Zimmerwald et, en mars 1919, le délégué du KPD au premier congrès de la Troisième Internationale, Hugo Eberlein, s'abstient lors du vote sur la fondation de la nouvelle internationale. Le KPD lui avait demandé de voter contre, mais il a été persuadé à Moscou de la justesse de la décision et s'est donc abstenu.
Lorsque le SPD indépendant (USPD) a été créé en 1917 par des membres du SPD du Reichstag [parlement allemand] qui avaient été exclus du SPD parce qu'ils refusaient de voter de nouveaux crédits pour la guerre, Luxemburg et le Spartakusbund ont rejoint cette organisation centriste en tant que faction. Ils l'ont fait en dépit du fait que parmi les dirigeants les plus éminents de l'USPD se trouvaient Karl Kautsky, ainsi qu'Eduard Bernstein, le dirigeant théorique du révisionnisme allemand.
Luxemburg a justifié cela dans un article affirmant que le Spartakusbund n'avait pas adhéré à l'USPD pour se dissoudre dans une opposition molle. 'Il a rejoint le nouveau parti - confiant dans une aggravation croissante de la situation sociale et travaillant pour elle - afin de pousser le nouveau parti en avant, afin d'être sa conscience hortative... et afin de prendre la véritable direction du parti', écrivait-elle. [5]
Luxemburg s'en pris vivement à la Gauche de Brême - dirigée par Karl Radek et Paul Frölich, biographe ultérieur de Luxemburg - qui refusaient d'adhérer à l'USPD et la qualifiait de perte de temps. Elle dénonça leur plaidoyer pour un parti indépendant comme Kleinküchensystem (système de petites cuisines) et écrivit: 'Il est dommage que ce système de petites cuisines oublie l'essentiel, à savoir les circonstances objectives qui, en dernière analyse, sont décisives et seront décisives pour l'attitude des masses... Il ne suffit pas qu'une poignée de personnes aient la meilleure recette en poche et sachent comment diriger les masses. La pensée des masses doit être libérée des traditions vieilles de 50 ans. Cela n'est possible que dans le cadre d'un vaste processus d'autocritique intérieure permanente du mouvement dans son ensemble'. [6]
Ce n'est qu'en décembre 1918, un mois après que trois dirigeants de l'USPD aient rejoint un gouvernement provisoire dirigé par les dirigeants de droite du SPD Friedrich Ebert et Philipp Scheidemann, que le Spartakusbund rompit avec l'USPD. Le gouvernement d'Ebert devient le bourreau de la révolution de novembre. Il s'aligna rapidement sur le commandement militaire. L'USPD, qui avait fait son travail, n'était plus nécessaire.
À la fin de l'année, au milieu de luttes révolutionnaires acharnées, le KPD était finalement fondé par le Spartakusbund, la Gauche de Brême et un certain nombre d'autres organisations de gauche.
Le retard dans la fondation d'un véritable parti révolutionnaire, indépendant des sociaux-démocrates et des centristes, explique dans une certaine mesure les nombreuses tendances d'ultra-gauche qui se sont multipliées en Allemagne au début des années 1920. La trahison du SPD - d'abord en 1914, lorsqu'il a soutenu la guerre, puis en 1918, lorsqu'il a noyé la révolution dans le sang - a entraîné une vive réaction parmi les travailleurs qui, en l'absence d'une organisation résolue de type bolchevique, se sont tournés vers différentes formes de radicalisme de gauche, voire d'anarchisme. Ce problème va handicaper le KPD pendant longtemps.
Lors du congrès fondateur du KPD, Luxemburg était en minorité sur la question de la participation aux élections de l'assemblée nationale. La majorité était contre. Et les tendances d'ultra-gauche se multipliaient à l'extérieur du parti.
En avril 1920, après un soulèvement ouvrier armé dans la Ruhr, l'aile gauche se sépara du parti et forme le KAPD, qui promouvait des idées d'ultra-gauche, antiparlementaires et anarchistes. Le KAPD emportait avec lui une part considérable des membres du KPD - selon certaines sources, la majorité. Mais il se désintégra rapidement, faute de programme cohérent. Le Comintern, avec un certain succès, tenta de récupérer les sections saines du KAPD et l'invita même à l'un de ses congrès.
Cependant, en 1919, c'est surtout l'USPD qui profita du glissement à gauche de la classe ouvrière. Lors des élections au Reichstag de 1920, le SPD obtient 6 millions de voix, l'USPD 5 millions et le KPD 600 000.
L'USPD était un parti centriste classique. Les dirigeants évoluaient vers la droite, croisant les travailleurs qui évoluaient vers la gauche. De nombreux travailleurs qui soutenaient l'USPD admiraient l'Union soviétique. Les dirigeants de droite de l'USPD se retrouvaient de plus en plus isolés. Avec ses 21 conditions d'adhésion, le deuxième congrès du Comintern accentua les divisions au sein de l'USPD.
En décembre 1920, la majorité rejoignit finalement le KPD - ou le VKPD, comme on l'a appelé pendant un certain temps. La minorité rejoignit plus tard le SPD. La fusion avec l'USPD multiplia par cinq le nombre de membres du KPD et le transforma en un parti de masse. Mais les nouveaux membres apportaient avec eux de nombreux problèmes liés au passé et aux traditions centristes de l'USPD.
En mars 1921, un soulèvement raté en Allemagne centrale - la Märzaktion - provoqua une nouvelle crise dans les rangs du KPD. Après que le gouvernement national ait envoyé des unités de police dans les usines pour désarmer les travailleurs, le KPD et le KAPD appelèrent à une grève générale et au renversement du gouvernement national. Le soulèvement était manifestement prématuré. Il s'est soldé par une défaite sanglante.
Environ 2.000 travailleurs furent tués dans les combats et la répression féroce qui s'ensuivit. En conséquence, Paul Levi, un ami proche de Rosa Luxemburg et l'un des principaux dirigeants du parti, qui s'était, à juste titre, opposé au soulèvement dès le début, attaqua violemment le parti en public. Il fut finalement expulsé et réintégra le SPD.
Les événements du mois de mars allemand ont été au centre des débats du troisième congrès de l'Internationale communiste, qui s'est tenu du 22 juin au 21 juillet 1921 à Moscou. Trotsky qualifiera plus tard ce congrès de 'jalon' et en résumera l'importance comme suit: 'Il a établi le fait que les ressources des partis communistes n'étaient pas suffisantes: 'Il a établi le fait que les ressources des partis communistes, tant sur le plan politique qu'organisationnel, n'étaient pas suffisantes pour la conquête du pouvoir. Il a avancé le slogan: 'Aux masses', c'est-à-dire à la conquête du pouvoir par une conquête préalable des masses, réalisée sur la base de la vie et des luttes quotidiennes. Car la masse continue également à vivre sa vie quotidienne à une époque révolutionnaire, même si c'est d'une manière quelque peu différente. ...' [7]
Le troisième congrès a promu des revendications transitoires, la tactique du Front uni et le slogan d'un gouvernement ouvrier, afin de gagner la confiance des travailleurs qui soutenaient encore les sociaux-démocrates. Il insistait sur la nécessité de travailler dans les syndicats.
Cette démarche se heurta à la résistance acharnée des tendances de gauche et d'ultra-gauche du KPD, qui prônaient la 'théorie de l'offensive' et rejetaient toute forme de compromis, ainsi que le travail parlementaire et syndical. Ils étaient soutenus par Nikolaï Boukharine, futur dirigeant de l'Opposition de droite, qui plaidait pour 'une offensive révolutionnaire ininterrompue'. C'est en réponse à ces tendances que Lénine écrivit son pamphlet 'La Maladie infantile du communisme (le 'gauchisme')'.
En étudiant ces conflits, on remarquera que Lénine et Trotsky ont adopté une approche extrêmement patiente à l'égard des différentes factions du KPD. Ils ont tenté d'éduquer, d'expliquer, d'intégrer et de prévenir les scissions prématurées. Ils ont contenu les têtes brûlées de gauche et de droite qui voulaient expulser leurs opposants. Ils ont essayé de maintenir Levi dans le parti, jusqu'à ce que son comportement provocateur rende la chose impossible.
Pendant le troisième congrès, ils ont passé des heures à discuter en petits groupes avec différentes factions du KPD. Tout en étant intransigeants à l'égard de la gauche infantile, ils ont également perçu un élément de conservatisme dans la direction du parti, auquel ces gauches réagissaient. En d'autres termes, Lénine et Trotsky ont essayé de développer une direction tempérée et expérimentée, formée pour faire face aux contradictions et pour réagir rapidement à une situation changeante. Cela contrastait fortement avec les pratiques ultérieures du Comintern sous Staline.
Les évènements de la Ruhr
Revenons maintenant aux événements de 1923.
Un an et demi après le troisième congrès du Comintern, les conflits au sein du Parti communiste allemand (KPD) ne s’étaient pas vraiment résolus. Après l'occupation de la Ruhr par l'armée française, le conflit entre la majorité dirigeante et l'opposition de gauche éclata à nouveau avec force. Des divergences apparaissaient sur le soutien apporté par le KPD à un gouvernement de gauche du parti social-démocrate (SPD) en Saxe et sur l'attitude à adopter dans la Ruhr occupée.
Le parti était désormais dirigé par Heinrich Brandler, membre fondateur du Spartakusbund. Alors que beaucoup d'anciens gauchistes avaient viré nettement à droite, une nouvelle faction de gauche s'était formée sous la direction de Ruth Fischer, Arkadi Maslow et, dans une moindre mesure, de Ernst Thälmann. Fischer et Maslow étaient tous deux de jeunes intellectuels qui avaient rejoint le mouvement après la guerre. Ils avaient derrière eux la majorité de l'importante organisation berlinoise. Thälmann était un ouvrier qui avait rejoint le KPD par l'intermédiaire du SPD indépendant (USPD). Il est le dirigeant du KPD à Hambourg.
Le 10 janvier, le gouvernement SPD de Saxe tomba et le KPD mena une campagne en faveur d'un front uni et d'un gouvernement ouvrier. Alors que la majorité du SPD était favorable à une coalition avec les partis bourgeois, une minorité de gauche se prononça en faveur d'une alliance avec le KPD. Le KPD développa une agitation vigoureuse et publia un 'programme ouvrier', qui incluait parmi ses revendications: la confiscation des biens de l'ancienne famille royale, l'armement des travailleurs, l'épuration de la justice, de la police et de l'administration, la convocation d'un congrès des conseils d'usine et le contrôle des prix par des commissions élues.
Cette initiative trouva un soutien au sein du SPD, où l'aile gauche forma finalement une majorité. Elle accepta le 'programme ouvrier' à une exception près: la dissolution du parlement et la convocation d'un congrès des conseils d'usine. Sur cette base, un gouvernement SPD fut formé avec le soutien du KPD.
Cette démarche fut soutenue par la majorité de la direction du KPD et par Karl Radek, qui était alors devenu une figure de proue du Comintern mais farouchement dénoncée par la gauche du KPD. Ces derniers considéraient le soutien au gouvernement de Saxe non seulement comme une mesure tactique temporelle visant à gagner les travailleurs sociaux-démocrates, mais aussi comme une adaptation politique à l'aile gauche des sociaux-démocrates, qu'ils considéraient comme non moins perfide que l'aile droite. Leur méfiance n'était pas sans fondement, comme le montreront les événements ultérieurs: Le 21 octobre, Brandler annule l'insurrection préparée parce que les sociaux-démocrates de gauche n’étaient pas prêts à la soutenir.
Dans la Ruhr, le KPD pris clairement ses distances avec le SPD, qui soutenait pleinement la campagne de 'résistance passive' du gouvernement de Wilhelm Cuno. Le gouvernement Cuno, quant à lui, collaborait avec des bandes paramilitaires, secrètement soutenues par l'armée, et avec des éléments ouvertement fascistes, les encourageant à commettre des actes de sabotage contre les occupants français. Cela attira dans la Ruhr des droitiers et des fascistes venus de toute l'Allemagne. Le SPD se retrouva dans une alliance de fait avec ces forces.
Le KPD dénonçait le nationalisme du SPD comme une répétition de sa politique de 1914, lorsqu'il avait voté les crédits de guerre, et s'y opposa fermement. Il appella à la lutte contre les occupants français et le gouvernement de Berlin. Un numéro du Rote Fahne titrait ainsi: 'Combattez Poincaré et Cuno dans la Ruhr et sur la Spree'. Cette ligne se trouva rapidement confirmée lorsque les travailleurs commencèrent à se rebeller contre les conditions sociales insupportables, protestant à la fois contre les occupants, les industriels locaux et le gouvernement berlinois.
Mais les dirigeants de la gauche du KPD ne tardèrent pas à intervenir en organisant des réunions du parti dans la Ruhr. Ruth Fischer préconisa d'appeler les travailleurs à s'emparer des usines et des mines, à prendre le pouvoir politique et à établir une République ouvrière de la Ruhr. Cette République deviendrait alors la base d'une armée ouvrière qui 'marcherait en Allemagne centrale, prendrait le pouvoir à Berlin et écraserait une fois pour toutes la contre-révolution nationaliste.' [8]
Cette ligne était aventureuse, une répétition de celle de l'action de mars, en 1921. Un soulèvement dans la Ruhr serait resté isolé, car aucun soutien n'était préparé dans le reste de l'Allemagne. En outre, la Ruhr regorgeait de forces paramilitaires et fascistes et l'armée française n'aurait guère accepté passivement un soulèvement prolétarien. Alors que les occupants français considéraient avec une certaine sympathie les grèves dirigées contre le gouvernement allemand, il en aurait été tout autrement d'une insurrection prolétarienne.
Alors que la lutte des factions en Allemagne devenait de plus en plus âpre, Zinoviev, le secrétaire du Comintern, invita les deux parties à Moscou, où un compromis fut trouvé. L'Internationale communiste approuva le soutien apporté par le KPD au gouvernement SPD de Saxe, mais critiqua certaines formulations, indiquant qu'il s'agissait plus que de seulement une tactique temporaire. Elle rejeta les plans de Fischer pour la Ruhr.
La résolution de compromis, adoptée à l'unanimité, ne donnait aucune indication que la direction du Comintern était consciente de la rapidité croissante des événements en Allemagne ou qu'elle en tirait des conclusions. Au contraire, la résolution stipulait ce qui suit: 'Les divergences proviennent de la lenteur des développements révolutionnaires en Allemagne et des difficultés objectives qui en découlent, alimentant simultanément les déviations de droite et de gauche.' [9]
La ligne Schlageter
En juin, Radek a introduit une nouvelle diversion qui a encore plus désorienté le KPD déjà confus - la ligne dite de Schlageter.
Le KPD s'inquiétait depuis un certain temps de la montée du fascisme en Allemagne. En octobre 1922, Mussolini avait pris le pouvoir à Rome, après une campagne de terreur de ses détachements armés, les fasci, contre les organisations ouvrières et les militants ouvriers.
En Allemagne, l'extrême droite se limitait jusque-là aux restes de l'armée impériale et aux petits partis antisémites. Mais en 1923, elle a commencé à se développer et à gagner une base sociale, même si celle-ci était beaucoup plus petite que la base sociale d'Hitler dans les années 1930. L'agitation contre les 'criminels de novembre', les Juifs et les étrangers trouva un écho parmi les éléments petits-bourgeois déclassés et certains travailleurs appauvris touchés par l'impact de l'inflation. Dans la Ruhr, les membres de l'extrême droite se présentèrent comme des combattants héroïques contre l'occupation française.
La Bavière en particulier, avec ses vastes zones rurales, est devenue un bastion de l'extrême droite. Après la répression sanglante de la République soviétique de Munich en 1919, elle s'était transformée en un foyer d'organisations nationalistes, fascistes et paramilitaires.
Le 7 avril, Albert Schlageter, membre des Freikorps, a été arrêté par l'armée française à Düsseldorf pour avoir participé à des attentats à la bombe sur des voies ferrées. Il a été condamné à mort par un tribunal militaire et exécuté le 26 mai. La droite l'a immédiatement transformé en martyr. Lors d'une réunion du Comité exécutif du Komintern (ECCI) en juin, Radek proposa que le KPD gagne les ouvriers et les éléments petits-bourgeois séduits par les fascistes en se joignant à cette campagne et en s'adaptant au nationalisme des fascistes.
'Les masses petites-bourgeoises et les intellectuels et techniciens qui joueront un grand rôle dans la révolution se trouvent dans une position d'antagonisme national envers le capitalisme, qui les déclasse', a annoncé Radek. 'Si nous voulons être un parti ouvrier capable d'entreprendre la lutte pour le pouvoir, nous devons trouver le moyen de nous rapprocher de ces masses, et nous n'y parviendrons pas en fuyant nos responsabilités, mais en affirmant que la classe ouvrière seule peut sauver la nation.' [10]
Plus tard au cours de la réunion, il a solennellement loué Schlageter, qui, bien que 'vaillant soldat de la contre-révolution', 'mérite néanmoins un sincère hommage de notre part en tant que soldat de la révolution'. 'Le sort de ce martyr du nationalisme allemand ne doit pas être oublié, ni simplement honoré par un simple mot', a déclaré Radek. 'Nous ferons tout pour que les hommes qui, comme Schlageter, étaient prêts à donner leur vie pour une cause commune, ne deviennent pas des vagabonds dans le vide, mais des vagabonds vers un avenir meilleur pour l'humanité tout entière.'
La ligne Schlageter fut reprise dans le Rote Fahne [le journal du KPD] et y domina pendant plusieurs semaines. Cela créa une grande confusion dans les rangs communistes, qui avaient jusqu'ici résisté aux pressions nationalistes. Rien n’indique qu’il ait affaibli les rangs des fascistes – à l’exception de quelques têtes brouillonnes national-bolcheviques qui ont rejoint le KPD et ont créé beaucoup de troubles avant que celui-ci puisse à nouveau s’en débarrasser. La campagne Schlageter a fourni de nombreuses munitions à la propagande anticommuniste du SPD et a rendu très difficile au Parti communiste français (PCF) d'organiser la solidarité parmi les soldats français en faveur des travailleurs allemands.
Les grèves Cuno
Tandis que Radek développait la ligne Schlageter, la lutte des classes en Allemagne s'intensifiait. En juin et juillet, des émeutes et des grèves contre la hausse des prix ont éclaté dans tout le pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes y ont régulièrement participé, parmi lesquelles des sections de travailleurs qui n'avaient jamais participé à une lutte sociale auparavant. Pour ne citer qu'un exemple: début juin, 100.000 ouvriers agricoles en Silésie et 10.000 journaliers dans le Brandebourg se sont mis en grève.
Le 8 août, le chancelier Cuno s'est adressé au Reichstag. Il a exigé de nouvelles réductions et attaques contre la classe ouvrière et a combiné cette exigence avec un vote de confiance. Le SPD a tenté de sauver son gouvernement en s'abstenant lors du vote.
À partir de Berlin, une vague spontanée de grèves s'est développée, exigeant la démission du gouvernement Cuno. Le 10 août, une conférence de représentants syndicaux a rejeté l'appel à la grève générale sous la pression du SPD. Mais le lendemain, une conférence des conseils d'usine, convoquée à la hâte par le KPD, prit l'initiative et annonça une grève générale. Trois millions et demi de travailleurs y ont participé. Dans plusieurs villes, des affrontements ont eu lieu avec la police, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les travailleurs. Le lendemain, le gouvernement Cuno démissionna.
La domination bourgeoise fut profondément ébranlée. 'Il n’y a jamais eu de période dans l’histoire moderne de l’Allemagne qui ait été aussi favorable à une révolution socialiste que l’été 1923', écrit Arthur Rosenberg. Pour le moment, le SPD sauva le régime bourgeois. Contre une résistance considérable dans ses propres rangs, il a rejoint un gouvernement de coalition dirigé par Gustav Stresemann du Deutsche Volkspartei (DVP), un parti du grand patronat.
Préparer la révolution
Ce n’est qu’à ce moment-là, après les grèves contre Cuno en août, que le KPD et le Komintern ont pris conscience de l’opportunité révolutionnaire qui s’était développée en Allemagne et ont changé de cap. Le 21 août, soit exactement deux mois avant l'annulation de l'insurrection par Brandler, le Bureau politique du Parti communiste russe décida de préparer une révolution en Allemagne. Il créa une 'Commission des affaires internationales' pour superviser les travaux en Allemagne. Il était composé de Zinoviev, Kamenev, Radek, Staline, Trotsky et Chicherin – et plus tard de Dzerjinski, Piatakov et Sokolnikov.
Dans les jours et les semaines qui suivirent, de nombreuses discussions et une correspondance continue eurent lieu avec les dirigeants du KPD, qui se rendaient fréquemment à Moscou. Un soutien financier, logistique et militaire fut organisé pour armer les Centaines prolétariennes, constituées au cours des mois précédents. En octobre, Radek, Piatakov et Sokolnikov furent envoyés en Allemagne pour assister au soulèvement.
Mais c’est surtout Trotsky qui s’est battu sans relâche pour vaincre le fatalisme et la complaisance existant tant dans la section allemande que dans le parti russe. Tandis que Staline, pas plus tard que le 7 août, c'est-à-dire un jour avant le déclenchement des grèves contre Cuno, écrivait à Zinoviev : 'À mon avis, les Allemands doivent être retenus et non encouragés' et 'Pour nous, ce serait un avantage si les fascistes frappent les premiers', Trotsky a insisté sur le fait que l’insurrection devait être préparée en quelques semaines plutôt qu’en mois et qu’une date définitive devait être fixée. [11]
Ce qui, à première vue, semblait être une proposition d'organisation – la fixation d'une date – était en fait une revendication éminemment politique. Pour Trotsky, la tâche principale était désormais de concentrer toute l’énergie et l’attention du parti sur la préparation de la révolution. D'une préparation propagandiste plus générale, il fallut passer à la préparation pratique de l'insurrection.
Lors d'une réunion du bureau politique du parti russe le 21 août, il déclara: 'En ce qui concerne l'état d'esprit des masses révolutionnaires en Allemagne, le sentiment qu'elles sont en route vers le pouvoir, ce sentiment existe. La question posée est celle de la préparation. Le chaos révolutionnaire ne doit pas être approuvé d’office. La question est: soit nous déclenchons la révolution, soit nous l’organisons.' Trotsky a mis en garde contre le danger que des fascistes bien organisés brisent les actions non coordonnées des travailleurs et a exigé: 'Le KPD doit fixer un délai pour la préparation, pour la préparation militaire et – selon un rythme approprié – pour l'agitation politique.'
Staline s’y est fortement opposé. Il s'est opposé à un calendrier, affirmant que 'les travailleurs croient toujours en la social-démocratie' et que le gouvernement pourrait durer encore huit mois. [12]
Brandler, dans une lettre adressée à l'exécutif du Komintern le 28 août, plaide également en faveur d'une période plus longue: 'Je ne crois pas que le gouvernement Stresemann vivra trop longtemps', écrit-il. ' Je ne crois néanmoins pas que la prochaine vague, qui approche déjà, tranchera la question du pouvoir. ... Nous essaierons de concentrer nos forces afin de pouvoir, si cela s'avère inévitable, reprendre la lutte dans six semaines. Mais en même temps, nous prenons des dispositions pour être prêts avec un travail plus solide dans cinq mois.' Il a ajouté qu'il pensait qu'une période de six à huit mois était la plus probable. [13]
Lors d'une nouvelle discussion entre la commission russe et les dirigeants allemands un mois plus tard, Trotsky revint sur la question du calendrier. Il interrompit une discussion sur l'attitude à l'égard de la question de la Ruhr et déclara: 'Je ne comprends pas pourquoi tant d'attention est consacrée à la question de la Ruhr. ... L'enjeu est désormais de prendre le pouvoir en Allemagne. C’est là la tâche, tout le reste en découlera.'
Trotsky a ensuite répondu aux inquiétudes selon lesquelles les travailleurs allemands se battraient pour des revendications économiques, mais pas aussi facilement pour des objectifs politiques. 'L'inhibition politique n'est rien d'autre qu'un certain doute que les défaites précédentes ont laissé dans le cerveau des masses', a-t-il déclaré. 'Le parti ne peut gagner la classe ouvrière allemande dans la lutte révolutionnaire décisive – et la situation est là maintenant – que s’il convainc une grande partie de la classe ouvrière, sa section dirigeante, qu’il est également capable, sur le plan organisationnel, de la mener à la victoire dans le sens le plus concret du terme. ... Si le parti exprime des tendances fatalistes dans une telle situation, c'est le plus grand danger.'
Trotsky explique ensuite que le fatalisme peut prendre différentes formes: Premièrement, on dit que la situation est révolutionnaire et on le répète chaque jour. On s'y habitue et la politique est d'attendre la révolution. Alors on donne des armes aux travailleurs et on dit que cela mènera à un conflit armé. Mais ce n’est qu’un 'fatalisme armé'.
Trotsky concluait des informations que lui fournissaient les camarades allemands qu'ils concevaient cette tâche beaucoup trop facilement. 'Si la révolution doit être plus qu’une perspective confuse, dit-il, si elle doit être la tâche principale, il faut en faire une tâche pratique et organisationnelle. ... Il faut fixer une date, se préparer et se battre.' [14]
Le 23 septembre, Trotsky a même publié un article dans la Pravda: 'Une contre-révolution ou une révolution peut-elle être faite dans les délais?' Trotsky a discuté de la question en termes généraux sans mentionner l'Allemagne, car un appel à fixer une date pour la révolution allemande par un représentant éminent de la direction soviétique aurait provoqué une crise internationale, voire une guerre. Cet article constitue néanmoins une contribution au débat sur l’Allemagne.
La révolution manquée
Finalement, la date du soulèvement fut fixée au 9 novembre. Mais les événements s'accélérèrent.
Le 26 septembre, le chancelier Stresemann annonça la fin de la résistance passive contre l'occupation française de la Ruhr. Il a fait valoir qu’il n’y avait pas d’autre moyen de maîtriser l’hyperinflation. Cela a provoqué l’extrême droite. Le même jour, le gouvernement bavarois décrèta l'état d'urgence et installa une dictature dirigée par Ritter von Kahr. Von Kahr a collaboré avec les nazis d'Hitler et, imitant la marche de Mussolini sur Rome, a planifié une marche sur Berlin pour installer une dictature au niveau national. Kahr était soutenu par le commandant des unités de la Reichswehr positionnées en Bavière.
Le gouvernement berlinois a réagi en instaurant sa propre forme de dictature. L'ensemble du pouvoir exécutif fut transféré au ministre de la Défense, qui le délégua au général Hans von Seeckt, commandant de la Reichswehr. Seeckt sympathisait avec l'extrême droite et refusait de discipliner les commandants rebelles bavarois. Des industriels de premier plan, comme Hugo Stinnes, ont soutenu le projet d'une dictature nationale, optant pour Seeckt comme dictateur.
Le 13 octobre, le Reichstag, après plusieurs jours de discussions, a adopté une loi d'autonomisation, autorisant le gouvernement à abolir les acquis sociaux de la révolution de novembre, y compris la journée de huit heures. Le SPD a voté pour la loi d'autonomisation. Alors qu'un coup d'État menaçait Berlin, qui aurait facilement pu coûter la vie à certains ministres et députés du SPD, ces ministres et députés du SPD étaient occupés à décider de nouvelles attaques contre la classe ouvrière.
La Saxe et la Thuringe furent les centres de la résistance ouvrière contre ces préparatifs contre-révolutionnaires. Dans les deux Länder, le KPD a rejoint les gouvernements de gauche du SPD, respectivement les 10 et 16 octobre. Cela faisait partie du plan élaboré à Moscou. En entrant dans un gouvernement de coalition, le KPD espérait une position plus forte et un accès aux armes.
Mais bien que les deux gouvernements aient été formés conformément au droit en vigueur et disposaient d'une majorité parlementaire, le commandant de la Reichswehr en Saxe, le général Müller, a refusé de reconnaître leur autorité. En accord avec le gouvernement berlinois, il subordonna la police à son propre commandement.
Menacé par la Bavière, limitrophe de la Saxe et de la Thuringe au sud, et par le gouvernement central de Berlin, situé au nord, le KPD a dû faire avancer ses plans de révolution. Il a convoqué un congrès des conseils d'usine à Chemnitz, en Saxe, le 21 octobre. Ce congrès était censé appeler à la grève générale et donner le signal de l'insurrection dans toute l'Allemagne.
Mais comme les sociaux-démocrates de gauche n’étaient pas d’accord, Brandler a annulé le projet et a annulé le soulèvement. Une majorité des délégués aurait soutenu l’appel à la grève générale, comme Brandler l’a écrit dans une lettre privée à Clara Zetkin, qui était sa proche confidente. Mais il ne voulait pas agir sans le soutien des sociaux-démocrates de gauche.
'Pendant la conférence de Chemnitz, j'ai réalisé que nous ne pouvions en aucun cas entrer dans la lutte décisive, tant que nous n'avions pas réussi à convaincre la gauche du SPD de signer la décision de grève générale', a écrit Brandler. 'Face à une résistance massive, j’ai changé de cap et j’ai empêché nous, les communistes, d’entrer seuls dans la lutte. Bien sûr, nous aurions pu obtenir une majorité des deux tiers pour une grève générale lors de la conférence de Chemnitz. Mais le SPD aurait quitté la conférence et ses slogans confus, selon lesquels l'intervention du Reich contre la Saxe n'avait pour but que de dissimuler l'intervention du Reich contre la Bavière, auraient brisé notre combativité. J’ai donc consciemment travaillé en faveur d’un mauvais compromis.' [15]
La décision d’annuler la révolution n’est pas parvenue à temps à Hambourg. Là, une insurrection fut organisée, mais elle resta isolée et fut vaincue en trois jours.
Alors que le congrès de Chemnitz se réunissait encore, la Reichswehr commença à occuper la Saxe. Les conflits armés ont fait plusieurs morts parmi les travailleurs. Le 28 octobre, le président Friedrich Ebert, social-démocrate, a donné l'ordre de lancer le Reichsexekution contre la Saxe, c'est-à-dire ordonné le renversement par la Reichswehr du gouvernement de Saxe dirigé par Erich Zeigner, lui-même social-démocrate. L'indignation du public fut telle que le SPD fut obligé de démissionner du gouvernement Stresemann à Berlin. Quelques jours plus tard, la Reichswehr entra en Thuringe et y renversa le gouvernement.
La destitution de ces deux gouvernements de gauche par Ebert et Seeckt a encouragé l'extrême droite en Bavière. Le 8 novembre, Adolf Hitler proclama une 'révolution nationale' à Munich et organisa un coup d’État. Son objectif était de forcer le dictateur bavarois Kahr à marcher sur Berlin et à y prendre le pouvoir. Hitler était soutenu par le général Ludendorff, l'un des plus hauts commandants de la Première Guerre mondiale.
Le coup d’État Hitler-Ludendorff échoua. Berlin s'était déjà tellement orienté vers la droite que la droite bavaroise n'avait plus besoin d'un personnage aussi douteux qu'Hitler. Ebert s'est accommodé du coup d'État en déléguant le commandement de toutes les forces armées et le pouvoir exécutif à Seeckt. Alors que les institutions de la République de Weimar existaient encore formellement, l’Allemagne a été désormais gouvernée par une dictature militaire de facto jusqu’en mars 1924.
Pourquoi le KPD a-t-il manqué la révolution?
La réponse simpliste à cette question est de tout rejeter sur Brandler. Telle fut la réaction de Zinoviev et de Staline, qui firent de Brandler un bouc émissaire. En même temps, ils accusaient le KPD (Parti communiste allemand) d'avoir fourni des informations erronées sur la situation en Allemagne qui exagéraient le potentiel révolutionnaire de la situation. De cette manière, ils remettaient en question l’ensemble de l’évaluation sur laquelle était fondé le projet d’insurrection révolutionnaire.
Moins de trois semaines après l’annulation de l’insurrection, ils commencèrent à réinterpréter les événements d’Allemagne. Ils l’ont fait pour dissimuler leur propre rôle et pour des raisons factionnelles, alors que la lutte avec l’Opposition de gauche avait désormais pleinement éclaté. Le 15 octobre fut publié le premier document majeur de l'opposition de gauche, la Déclaration des 46. Fin novembre, Trotsky publia Cours nouveau.
Trotsky a rejeté l’approche simpliste adoptée par Zinoviev et Staline. Il n'était pas d'accord avec la décision de Brandler d'annuler l'insurrection. Mais il ne considérait pas cela comme un événement isolé. Après tout, Karl Radek, présent à Chemnitz en tant que représentant de l'Internationale Communiste, ainsi que la Centrale allemande, la direction centrale du parti, étaient d'accord avec la décision de Brandler.
L’insistance de Brandler sur le fait que la révolution échouerait – et que les communistes seraient isolés s’ils déclenchaient une insurrection sans le soutien des sociaux-démocrates de gauche – était conforme aux erreurs précédentes dont non seulement Brandler était responsable, mais aussi le Komintern. Tant le Komintern dirigé par Zinoviev que la direction du Parti communiste allemand (sa majorité et son aile gauche) ont affiché pendant longtemps une attitude passive, typiquement 'centriste', face aux événements qui se déroulaient en Allemagne. Bien que la situation sociale et politique ait radicalement changé après l’occupation française de la Ruhr en janvier, ils ont continué à travailler avec des méthodes politiques développées à un stade antérieur, lorsque la révolution n’était pas à l’ordre du jour immédiat.
Ce n'est que très tard, au milieu des événements d'août, qu'ils changèrent de cap et commencèrent à préparer l'insurrection. Cela ne leur laissait que deux mois pour se préparer, et les préparatifs étaient décousus, hésitants et insuffisants.
Trotsky, dans un discours prononcé devant le 5e Congrès pan-syndical des travailleurs médicaux et vétérinaires en juin 1924, donna les raisons suivantes pour expliquer la défaite: 'Quelle était la cause fondamentale de la défaite du Parti communiste allemand?' A-t-il demandé. 'C'est qu'il n'a pas apprécié à temps l'apparition de la crise révolutionnaire dès le moment de l'occupation de la Ruhr, et surtout depuis le moment de la fin de la résistance passive (janvier-juin 1923). Il a raté le moment crucial. ... Même après le début de la crise de la Ruhr, il a continué à poursuivre son travail d'agitation et de propagande sur la base de la formule du Front unique, au même rythme et sous les mêmes formes qu'avant la crise. Entre-temps, cette tactique était déjà devenue radicalement insuffisante. L’influence politique du parti s’accroissait automatiquement. Un virage tactique brusque s’imposait.
'Il fallait montrer aux masses, et surtout au parti lui-même, qu'il s'agissait cette fois d'une préparation immédiate à la prise du pouvoir. Il était nécessaire de consolider l’influence croissante du parti sur le plan organisationnel et d’établir des bases de soutien pour une attaque directe contre l’État. Il fallait transférer toute l'organisation du parti sur la base des cellules d'usine. Il fallait former des cellules sur les chemins de fer. Il fallait poser avec acuité la question du travail dans l'armée. Il était nécessaire, tout particulièrement nécessaire, d'adapter pleinement et complètement la tactique du Front unique à ces tâches, de lui donner un rythme plus décidé et plus ferme et un caractère plus révolutionnaire. Sur cette base, il aurait fallu mener des travaux de nature militaro-technique. ...
'Mais le plus important était d'assurer à temps un tournant tactique décisif vers la prise du pouvoir. Et cela n’a pas été fait. Ce fut l’omission principale et fatale. De là découle la contradiction fondamentale. D'une part, le parti attendait une révolution, et d'autre part, parce qu'il s'était brûlé les doigts lors des événements de mars, [Trotsky fait ici référence à 1921] il évitait, jusqu'aux derniers mois de 1923, l'idée même d'organiser une révolution, c'est-à-dire préparer une insurrection. L’activité politique du parti s’est déroulée à un rythme de temps de paix, à l’heure où le dénouement approchait.
'Le moment du soulèvement a été fixé alors que, pour l'essentiel, l'ennemi avait déjà utilisé le temps perdu par le parti et renforcé sa position. La préparation militaro-technique du parti, commencée à un rythme fébrile, était séparée de l’activité politique du parti, qui se déroulait au rythme précédent du temps de paix. Les masses n’ont pas compris le parti et n’ont pas suivi son rythme. Le parti se sentit immédiatement séparé des masses et se trouva paralysé. De là a résulté le retrait soudain des positions de premier ordre sans combat – la plus dure de toutes les défaites possibles.' [16]
Était-il possible d’organiser avec succès une insurrection nationale en octobre 1923?
Il existe un certain nombre de rapports émanant de dirigeants communistes allemands, ainsi que de dirigeants et de spécialistes militaires du Komintern, présents en Allemagne, témoignant d'un très mauvais état de préparation. Des détachements de combattants – les soi-disant Centaines révolutionnaires – avaient été formés et entraînés, mais il n'y avait pratiquement pas d'armes disponibles. L’appareil de propagande du KPD – en raison des interdictions et de l’oppression – était dans un état lamentable. La communication et la coordination entre les régions du parti ont très mal fonctionné.
En revanche, les ouvriers combattant à Hambourg ont fait preuve d'un courage, d'une discipline et d'une efficacité exceptionnels. Seuls 300 travailleurs se sont battus sur les barricades, mais ils ont rencontré une réponse large, positive, bien que largement passive, au sein de la population dans son ensemble.
Dans son discours devant les travailleurs médicaux et vétérinaires, Trotsky a souligné que la dynamique de la révolution elle-même devait être prise en compte. 'Les communistes avaient-ils derrière eux la majorité des masses laborieuses?' a-t-il demandé. 'C’est une question à laquelle on ne peut répondre avec des statistiques. C’est une question qui est tranchée par la dynamique de la révolution.
'Les masses étaient-elles d’humeur combative?' Poursuit-il. 'Toute l’histoire de l’année 1923 ne laisse aucun doute à ce sujet.' Et Trotsky de conclure : 'Dans de telles conditions, les masses ne pouvaient avancer que s'il y avait une direction ferme et sûre d'elle-même et une confiance de la part des masses dans cette direction. Les discussions sur la question de savoir si les masses étaient ou non d’humeur combative sont de caractère très subjectif et expriment essentiellement le manque de confiance parmi les dirigeants du parti lui-même.' [17]
Leçons d’Octobre
La capitulation sans combat était certainement la pire issue possible aux événements allemands. Cela a démoralisé et désorganisé le KPD et créé les conditions permettant à l’élite dirigeante et à l’armée de passer à l’offensive et de consolider leur pouvoir. Trotsky insistait donc sur le fait que les leçons de la défaite allemande devaient être impitoyablement tirées. Il rejetait catégoriquement le fait de désigner des boucs émissaires, ce qui n'est qu'un moyen d'éviter les questions politiques les plus fondamentales. Tirer ces leçons n’était pas seulement indispensable pour préparer les dirigeants allemands aux futures opportunités révolutionnaires, qui se présenteraient inévitablement. C’était également crucial pour toutes les autres sections du Komintern, qui seraient confrontées à des défis et à des problèmes similaires.
Trotsky a noté que les leçons de la Révolution russe d’Octobre – la seule révolution prolétarienne réussie de l’histoire – n’avaient jamais été correctement tirées. À l'été 1924, il publia le livre Leçons d'Octobre, discutant du succès d'Octobre russe à la lumière de la défaite allemande.
Il insista sur la nécessité 'd’étudier les lois et les méthodes de la révolution prolétarienne'. Il y avait des problèmes auxquels tout parti communiste serait confronté lorsqu’il entrait dans une période révolutionnaire: 'D’une manière générale, des crises surgissent dans le parti à chaque tournant sérieux de son évolution, soit comme prélude au tournant, soit comme conséquence de celui-ci. L'explication réside dans le fait que chaque période du développement du parti présente des caractéristiques particulières et requiert des habitudes et des méthodes de travail spécifiques. Un tournant tactique implique une rupture plus ou moins grande de ces habitudes et méthodes. C’est là que réside la racine directe et la plus immédiate des frictions et des crises internes au parti.'
Trotsky citait ensuite Lénine, qui écrivait en juillet 1917: 'Il arrive trop souvent que lorsque l'histoire prend un tournant brusque, même les partis les plus avancés soient incapables, pendant une période plus ou moins longue, de s'adapter aux nouvelles conditions. Ils répètent sans cesse les slogans d’hier, des slogans qui étaient corrects hier, mais qui ont perdu tout leur sens aujourd’hui, devenant 'tout à coup' vides de sens avec la même 'soudaineté' que l’histoire prend un tournant brusque.
'Par conséquent, concluait Trotsky, le danger apparaît que, si le tournant est trop brusque ou trop soudain et si, au cours de la période précédente, trop d'éléments d'inertie et de conservatisme se sont accumulés dans les organes dirigeants du parti, alors le parti se révèle incapable d'exercer sa direction à ce moment suprême et critique auquel il se prépare depuis des années ou des décennies. Le parti est ravagé par une crise et le mouvement ignore le parti et se dirige vers la défaite. ...
'Le tournant le plus brusque de tous est celui du parti prolétarien, du travail de préparation et de propagande, ou d'organisation et d'agitation, à la lutte immédiate pour le pouvoir, à l'insurrection armée contre la bourgeoisie. Ce qui reste dans le parti d'indécis, de sceptique, de conciliateur, de capitulatoire, bref de menchevik, tout cela refait surface contre l'insurrection, cherche des formules théoriques pour justifier son opposition et les trouve toutes faites dans l'arsenal des opposants opportunistes d'hier. Nous aurons l’occasion d’observer ce phénomène plus d’une fois dans le futur.' [18]
Zinoviev et Staline ont rejeté l’approche de Trotsky. Poussés par des motivations factionnelles et subjectives, ils ont falsifié les événements d’Allemagne, effacé leurs propres traces et fait de Brandler le bouc émissaire de tout ce qui n’allait pas. Les conséquences furent désastreuses. La direction du KPD a été remplacée – pour la cinquième fois en cinq ans – sans qu’aucune leçon n’en soit tirée.
Comme Radek l’a souligné lors d’un échange houleux avec Staline lors d’une réunion plénière du Comité central russe en janvier 1924, les cadres marxistes expérimentés ont été remplacés par des personnes qui avaient soit une formation au sein de l’USPD centriste (SPD indépendant), soit aucune expérience révolutionnaire. Heinrich Brandler, membre fondateur du Spartakusbund avec 25 ans d'expérience dans le mouvement, a été remplacé par Ruth Fischer et Arkadi Maslow, de jeunes intellectuels issus d'un riche milieu bourgeois sans passé révolutionnaire. Le groupe du Centre, qui formerait désormais la majorité de la nouvelle direction, n'avait rejoint le KPD qu'en décembre 1920, lorsque la majorité de gauche de l'USPD centriste s'unit au KPD.
Le remplacement de la direction a ouvert la voie - après de nouvelles purges et remplacements dans les années suivantes - à la subordination totale du KPD aux diktats de Staline, ce qui aurait des conséquences si dévastatrices dix ans plus tard, lorsque la ligne désastreuse du KPD a ouvert la voie vers le pouvoir à Hitler. L’alignement de Staline sur la gauche de Fischer et Maslow était particulièrement cynique, car il avait toujours occupé les positions les plus à droite au cours des événements. Staline a gagné l'allégeance de Maslow, qui faisait l'objet d'une enquête parce qu'il aurait donné des informations à la police lors des événements de mars 1921, en s'assurant qu'il était innocenté des accusations.
Même la théorie du social-fascisme, qui assimile la social-démocratie au fascisme, a trouvé sa première expression dans un document sur les événements allemands rédigé par Zinoviev et adopté par le présidium du Comité exécutif du Komintern contre la résistance de l'opposition de gauche en janvier 1924. On y lit: 'Les couches dirigeantes de la social-démocratie allemande ne sont actuellement rien d’autre qu’une faction du fascisme allemand sous un masque socialiste.' [19]
Après que le parti n’ait pas réussi à passer à temps de la tactique du Front uni à la lutte pour le pouvoir, Zinoviev et Staline ont complètement rejeté la tactique du Front uni. La théorie du social-fascisme, qui rejetait toute forme de front uni avec le SPD contre les nazis, fut relancée en 1929 et joua un rôle fatal dans le désarmement de la classe ouvrière dans la lutte contre le fascisme.
En 1928, Trotsky résuma une fois de plus les leçons fondamentales de l’Octobre allemand. Critiquant le projet de programme du VIe Congrès du Komintern, il écrivait: 'Le rôle du facteur subjectif dans une période de développement lent et organique peut rester tout à fait secondaire. Surgissent alors divers proverbes du progressisme, tels que: 'lent mais sûr', 'il ne faut pas donner de coups de pied contre les piqûres', etc., qui résument toute la sagesse tactique d’une époque organique qui abhorrait 'sauter par-dessus les étapes'. Mais dès que les conditions objectives ont mûri, la clé de tout le processus historique passe entre les mains du facteur subjectif, c'est-à-dire du parti. L’opportunisme, qui se nourrit consciemment ou inconsciemment de l’inspiration de l’époque passée, a toujours tendance à sous-estimer le rôle du facteur subjectif, c’est-à-dire l’importance du parti et de la direction révolutionnaire. Tout cela a été pleinement révélé lors des discussions sur les leçons d'Octobre allemand, sur le Comité anglo-russe et sur la révolution chinoise. Dans tous ces cas, ainsi que dans d’autres de moindre importance, la tendance opportuniste s’est manifestée dans l’adoption d’une ligne de conduite qui s’appuyait uniquement sur les 'masses' et qui, par conséquent, a complètement méprisé la question des 'sommets' de la direction révolutionnaire. Une telle attitude, qui est fausse en général, a un effet positivement fatal à l’époque impérialiste.' [20]
[1] Leon Trotsky, The Lessons of October, in The Challenge of the Left Opposition (1923-25), p. 201. Les Leçons d'Octobre, https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1924/09/lecons.pdf
[2] Arthur Rosenberg, (Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt am Main: Athenäum 1988), p. 395.
[3] Ibid., p. 402.
[4] Hermann Weber, (Die Wandlung des deutschen Kommunismus, Band 1, Frankfurt 1969), p. 43.
[5] Rosa Luxemburg, (Rückblick auf die Gothaer Konferenz, in Gesammelte Werke Band 4, Berlin 1974), p. 273.
[6] Ibid., p. 274.
[7] Leon Trotsky, (The Third International After Lenin, New Park: 1974), pp. 66-67. L'Internationale Communiste après Lénine, https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/ical/ical.html
[8] Cité par Pierre Broué (The German Revolution 1917-1923, Haymarket Books: 2006) p. 702. Révolution en Allemagne 1917-1923 - Collection Arguments, Les Editions de Minuit, 1971.
[9] Cité par Broué, ibid., p. 705.
[10] Cité par Broué, ibid., p. 726.
[11] Bernhard H. Bayerlein u.a. Hsg., (Deutscher Oktober 1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern, Berlin: 2003) p. 100.
[12] Ibid., pp. 122-27.
[13] Ibid., pp. 135-136.
[14] Ibid., pp. 165-167.
[15] Ibid., pp. 359.
[16] Leon Trotsky, [Through What Stage Are We Passing, in The Challenge of the Left Opposition (1923-25), Pathfinder Press, 1975], pp. 170-71.
[17] Ibid., p. 169.
[18] Leon Trotsky, (Lessons of October, New Park Publications, 1971), pp. 4-7. Les Leçons d'Octobre, https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1924/09/lecons.pdf
[19] Bernhard H. Bayerlein u.a. Hsg., (Deutscher Oktober 1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern, Berlin: 2003), p. 464.
[20] Leon Trotsky, (The Third International after Lenin, New Park, 1974), p. 64. L'Internationale Communiste après Lénine, https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/ical/ical.html