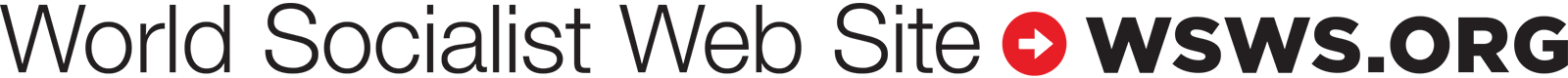Le gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva (Parti des travailleurs – PT) a entamé la seconde moitié de son mandat alors que les signes se multiplient au Brésil d'une crise économique et sociale grandissante. Dans un scénario économique national et international difficile marqué par la guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump, le gouvernement Lula prépare le terrain pour faire porter de plus en plus le poids de cette crise à la classe ouvrière brésilienne.
Fin 2024, le gouvernement Lula a réussi à faire passer un plan d'austérité qui aura un large impact sur les sections les plus pauvres et les plus opprimées de la classe ouvrière. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Son équipe économique réagit à un prétendu «marché en ébullition» et à la montée prévue de l’inflation cette année par des mesures visant à ralentir l'économie, réduire les dépenses et à prendre de nouvelles mesures d'austérité. Suivant le mantra de l'orthodoxie économique, l'objectif est de faire baisser les salaires en augmentant les taux d'intérêt, afin de maintenir la croissance des bénéfices de la grand entreprise.
Lors d'une interview le 31 janvier avec Estado de S. Paulo, le secrétaire au Trésor de Lula, Rogério Ceron, a déclaré qu' « il y a un consensus au sein du gouvernement sur la nécessité de garantir un ralentissement de l'économie afin d'éviter un dérapage inflationniste ». Il a précisé que cela impliquait «une politique fiscale plus restrictive au cours du premier semestre de l'année» et que «si des mesures fiscales supplémentaires sont nécessaires pour garantir les résultats recherchés par le gouvernement [un objectif de déficit zéro et le respect du nouveau cadre fiscal, qui limite les dépenses sociales], elles seront adoptées.»
À cette fin, une des mesures mises en œuvre par le gouvernement Lula consiste à augmenter encore les taux d'intérêt. Dans les deux premières années de son gouvernement, Lula avait critiqué plusieurs fois le président de la Banque centrale (BC) nommé par l'ex-président fasciste Jair Bolsonaro, Roberto Campo Neto, pour les taux d'intérêt élevés du pays. En juillet dernier, Lula l'a qualifié d'«adversaire politique et idéologique du modèle de gouvernance que nous poursuivons», c'est-à-dire un modèle censé donner la priorité à l'investissement productif, visant la «réindustrialisation» du pays, plutôt qu'au capital financier.
Mais maintenant que la grande majorité des directeurs de la Banque centrale et son président, Gabriel Galípolo, sont nommés directement par le gouvernement PT, on assiste à la poursuite de la politique monétaire de Campo Neto. Le ministre des finances, Fernando Haddad, a déclaré dans une interview vendredi dernier que «le remède pour corriger l'inflation est souvent d'augmenter les taux d'intérêt pour inhiber la hausse des prix». Fin janvier, la Banque centrale a porté le taux d'intérêt à 13,25 %, le taux réel le plus élevé au monde, et l'on s'attend à ce qu'il atteigne 15 % en avril.
Fin janvier, des chiffres économiques pour 2024 ont été publiés qui, du point de vue de classe du gouvernement Lula, justifie son inquiétude. En 2024, le produit intérieur brut (PIB) du Brésil a augmenté de 3,6 %, alors que cette année, le gouvernement s'attend à une croissance de 2,5 %. Il est également possible que l'économie brésilienne entre en récession technique (deux trimestres de baisse du PIB) en 2025.
L'an dernier, le Brésil a connu une augmentation de 4,8 % de l'inflation, principalement due à la hausse des prix alimentaires pour les plus pauvres. L'inflation des produits alimentaires destinés aux ménages était de 8,2 %, tandis que les produits alimentaires et les boissons ont fait grimper l'inflation de 2,3 points de pourcentage pour les familles à faible revenu, contre 0,9 point de pourcentage pour les familles à gros revenu.
Dans la première semaine de février, le gouvernement fédéral et les gouvernements des divers États ont augmenté les prix des carburants : une hausse de 2,4 % pour l'essence et de 4,2 % pour le diesel. La forte dépendance du Brésil à l'égard des camions pour la distribution des denrées alimentaires signifiera certainement que l'augmentation de ces prix sera répercutée sur les aliments, ce qui accentuera encore la perspective inflationniste. Le gouvernement s'attend à une inflation de 5,51 % cette année.
Il est illusoire de penser que le gouvernement Lula agira pour atténuer la dégradation accélérée des conditions de vie, en particulier pour les plus pauvres. Ignorant les énormes bénéfices réalisés l'an dernier par les trusts et les banques au Brésil, qui expliquent au moins en partie la hausse des prix alimentaires, Lula a déclaré le 6 février: «Je ne peux pas geler [les prix], [...] ce que nous devons faire, c'est d’en appeler aux hommes d'affaires, parler à l'ensemble du secteur et voir ce que nous pouvons faire pour garantir que le panier alimentaire de base du peuple brésilien rentre dans son budget avec une certaine flexibilité».
Le lendemain, le gouvernement a presque immédiatement démenti l'annonce que le ministère du développement social augmenterait la valeur de la ‘Bolsa Família’, l'un des plus importants programmes d'aide sociale pour personnes dans l'extrême pauvreté, contre la hausse des prix alimentaires. Dans une déclaration, le ministre Wellington Dias a été contraint de reconnaître que «toutes les actions de ce ministère sont prises conformément aux lignes directrices du gouvernement fédéral, en particulier en ce qui concerne la responsabilité fiscale».
La Bolsa Família et la Prestation continue en espèces (BPC), qui verse un salaire minimum aux personnes âgées et handicapées vivant dans l'extrême pauvreté, ont été attaquées par le programme d'austérité du gouvernement Lula, approuvé en décembre. Prévoyant une baisse du nombre de bénéficiaires – provoquée intentionnellement par le programme d'austérité du PT – et d'une faible hausse de la valeur de prestations qui dépendent de l'augmentation du salaire minimum – autre élément visé par le programme d'austérité – l'inégalité sociale dans l'un des pays les plus inégalitaires du monde va sans aucun doute s'accroître.
Un article du journal O Globo intitulé «La misère diminue, l'inégalité non: les experts expliquent pourquoi le Brésil ne distribue pas les revenus» rapporte début décembre que «l'IBGE [Institut brésilien de géographie et de statistiques] estime que l'inégalité aurait augmenté de 7,2 % en 2023» si l'on ne tenait pas compte de la Bolsa Família et de la BPC. En 2023, même si le PIB a augmenté de 3,2 %, l'inégalité sociale au Brésil était la même qu'en 2022, atteignant 0,518 selon le coefficient de Gini. Ce chiffre n'est dépassé que par les pays les plus pauvres d'Afrique.
Dans le même temps, l’article indique que, selon l'IBGE [Institut brésilien de statistique], le «marché en pleine effervescence [...] a principalement bénéficié aux groupes à revenus élevés, car ils dépendent davantage des salaires. En d'autres termes, les gains du marché du travail n'ont pas été appropriés par les plus vulnérables». En fait, même si le PIB du Brésil a augmenté au cours des quatre dernières années, le revenu moyen des travailleurs brésiliens est toujours au niveau d'avant la pandémie.
L'impact de l'aggravation des inégalités sociales dans la population active, fortement sous-estimé par le gouvernement et l'opinion publique bourgeoise, est brutal. Bien que le chômage soit officiellement à son niveau le plus bas depuis 2012, ayant atteint 6,6 % l'année dernière, cette statistique ne tient pas compte des travailleurs sous-employés, c'est-à-dire de ceux qui travaillent moins qu'is ne le voudraient ou ne cherchent pas d'emploi. Si ces chiffres étaient pris en compte, le taux de chômage doublerait. Dans les États les plus pauvres du Brésil, tels que Bahia et Pernambuco, le taux de chômage officiel dépasse déjà 11 %.
Ceux qui ont un emploi sont confrontés à des degrés d'exploitation brutaux. La plupart des travailleurs brésiliens du secteur formel travaillent dans les services et le commerce, des secteurs où prédomine l'échelle dite «6x1» (six jours de travail, un jour de repos), avec des horaires de travail de 44 heures par semaine ou plus. Près de 40 % des travailleurs brésiliens travaillent dans le secteur informel, ce chiffre atteignant plus de 50 % dans les États pauvres du Nord-Est.
Le gouvernement Lula s'efforce de peindre en rose la vie économique et sociale du pays mais cela se heurte frontalement à la réalité. Le 3 février, au début de l'année législative du Congrès brésilien, Lula a déclaré: «Au cours de ces deux années, le Brésil est devenu moins pauvre et moins inégal, avec des salaires en hausse, des revenus du travail plus élevés et une répartition des revenus plus équitable».
Mais les travailleurs brésiliens ne semblent pas d'accord. Fin janvier, un sondage d'opinion réalisé par Quaest a montré que, pour la première fois depuis le début de son mandat, Lula avait une cote de popularité négative. Son taux de popularité est passé de 52 % en décembre 2024 à 47 % en janvier 2025, dû aux difficultés économiques de la population brésilienne, aux bas salaires et à l'inflation élevée. Dans le nord-est, où le PT dispose d'une base électorale importante, principalement parmi les plus pauvres, le taux de popularité de Lula est passé de 67 % en décembre à 59 %.
Après l'effondrement du PT aux élections municipales de novembre dernier, l'inflation galopante, les mesures d'austérité du gouvernement et les promesses non tenues de Lula de revenir sur les réformes pro-entreprises des gouvernement de droite de Michel Temer (2016-2018) et Bolsonaro, la crainte monte que ce gouvernement n'ouvre la voie à un retour au pouvoir de l'extrême droite, comme aux États-Unis avec la réélection de Trump. Cette situation a entraîné des dissensions croissantes au sein du PT et parmi ses alliés.
En décembre, João Pedro Stédile, dirigeant du Mouvement des sans-terre (MST), a déclaré dans des interviews que «les politiques publiques [du gouvernement Lula] n'atteignent pas les plus pauvres d'entre nous, dans les banlieues et à la campagne» et que «la réforme agraire s'est arrêtée net au cours de ces deux années».
Avant que le gouvernement Lula n'approuve son plan d'austérité à la fin du mois de décembre, José Genuíno, dirigeant de longue date du PT et ancien président du parti, avait déclaré à TV Fórum que de telles mesures étaient «la voie de la défaite politique du PT. Je pense qu'il y a un climat d'appréhension dans les rangs du parti, un climat d'insatisfaction.... Je pense que nous sommes à la croisée des chemins».
D'importantes luttes de classe se profilent à l'horizon pour la classe ouvrière brésilienne et latino-américaine. L'année dernière, pratiquement tous les secteurs des employés publics fédéraux ont fait des grèves de plusieurs mois contre l'affirmation du gouvernement Lula qu’il n'y avait pas d'argent pour les services sociaux au Brésil.
Face à l'intensification de la crise économique et sociale, de plus en plus de travailleurs se heurteront au gouvernement PT, ainsi qu'aux syndicats qu'il contrôle et aux partis de la pseudo-gauche brésilienne qui font tout ce qu'ils peuvent pour donner une couverture aux attaques de plus en plus nombreuses contre les conditions de vie.
(Article paru en anglais le 13 février 2025)