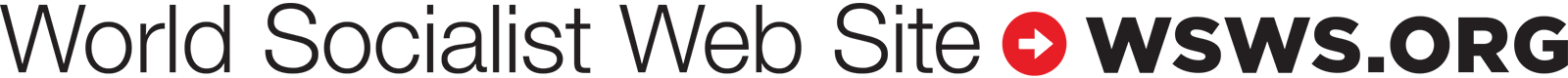Le dernier biopic de Napoléon, réalisé par Ridley Scott à l’âge de 85 ans, tente de retracer l'ascension et la chute de Napoléon Bonaparte, l'officier militaire qui s'est élevé sur la vague de la Révolution française, a orchestré un coup d'État en 1799 et s'est couronné empereur en 1804. Napoléon a finalement été vaincu été par les forces combinées de plusieurs puissances européennes à Waterloo (aujourd'hui en Belgique) en juin 1815. Il est mort en exil, sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique, six ans après.
Bonaparte (1769-1821) était une figure historique mondiale complexe. L’époque des guerres napoléoniennes (1803-1815), qui prennent leur origine dans la grande révolution de 1789 et les guerres révolutionnaires menées de 1792 à 1802, a été essentielle pour le développement de la société moderne.
Cependant Scott lui-même ne témoigne guère dans ses commentaires publics ou au cours du film lui-même un grand intérêt pour l'histoire et les processus historiques. Son Napoléon est une collection superficielle d'impressions, d'aperçus « psychologiques » du genre prix-unique et de brèves scènes de bataille, qui ne sont même pas présentées de manière à expliquer les prouesses militaires de Napoléon.
Napoléon commence avec les titres suivants : « 1789-La Révolution en France », « Les gens sont poussés par la misère à la révolution … et ramenés par la révolution à la misère ». Cette profonde intuition semble résumer le point de vue des réalisateurs, à savoir que la révolution - et peut-être l'histoire en général - est plutôt une perte de temps. La révolution a été un événement inutile, tout le monde s'est retrouvé dans une situation aussi mauvaise qu'au départ. En fin de compte, ils auraient dû rester au lit.
Quoi qu'il en soit, lorsque l'action du film commence le spectateur est précipité dans une séquence qui montre l'exécution de la reine Marie-Antoinette (Catherine Walker) en octobre 1793. Nous voyons la « foule » assoiffée de sang narguer la reine qui, stoïquement, lève la tête tout en défiant la guillotine, sous les jets de légumes pourris. Les sympathies de Scott sont ici évidentes. Le jeune Bonaparte (Joaquin Phoenix) est un spectateur distant et froid ; sa présence est liberté artistique qui ne repose sur rien.
Nous voyons ensuite le révolutionnaire jacobin Maximilien Robespierre (Sam Troughton) aborder la question de l'exécution de la reine devant la Convention nationale. « La terreur n'est rien sauf la justice, prompte, sévère, inflexible », affirme Robespierre, présenté sans sympathie.
Napoléon assiste à la séance de la Convention. Il rencontre Paul Barras (Tahar Rahim), une figure politique puissante qui deviendra plus tard membre du Directoire au pouvoir et qui cherche à reprendre la ville de Toulon, dans le sud de la France, aux forces royalistes alliées aux Britanniques. Le jeune officier d'artillerie dit à Barras : « Prenez le fort qui domine le port et vous aurez la ville ». Après avoir pris d'assaut la ville et mis en déroute la marine britannique, le succès de la victoire de Napoléon à Toulon augmente son rang et son prestique.
Après ce triomphe militaire, Barras déclare à Napoléon que Robespierre est « inapte à gouverner » en raison de sa « terreur sans loi ». Napoléon, auparavant un partisan de Robespierre qui avait aidé à promouvoir le jeune homme au rang de général de brigade, passe rapidement du côté de la réaction. Robespierre est dénoncé et destitué lors d'une réunion turbulente de la Convention au cours de la réaction thermidorienne de juillet 1794 (« Thermidor » était le 11e mois du nouveau calendrier républicain français). Il est envoyé à la guillotine, sous les acclamations d'une foule assoiffée de sang, tout comme elle avait acclamé la mort de Marie-Antoinette. La phase radicale de la Révolution française se termine ainsi et la consolidation du nouvel État et de la nouvelle société bourgeoise se met en place.
Le reste du film, d'une durée de deux heures et demie, passe d'un événement ou d'un épisode à l'autre et manque souvent de cohérence dramatique ou historique. Nous suivons la cour que Napoléon fait à la veuve aristocratique Joséphine de Beauharnais (Vanessa Kirby), puis sa campagne de 1798 en Égypte, une escapade à l'étranger dont le Directoire espérait qu'elle réduirait son prestige et sa popularité en France. Les événements en Égypte sont décrits de manière quelque peu ridicule, et les troupes françaises bombardent les Pyramides, une invention du film.
De retour en France, Napoléon accuse les dirigeants du Directoire de corruption et d'incompétence : « Je suis revenu en France pour la trouver en faillite ». Il commence à conspirer contre les figures au pouvoir, des personnalités telles qu'Emanuel Sieyès (Julian Rhind-Tutt), Charles Maurice de Talleyrand (Paul Rhys) et Joseph Fouché (John Hodgkinson), le ministre de la police, qui a déjà aidé à préparer la chute de Robespierre.
Le coup d'État fatidique du 18 Brumaire (9 novembre 1799) a lieu et conduit à l'arrivée au pouvoir de Napoléon. Le film est relativement précis sur ce point. Bonaparte a apparemment perdu son sang-froid et a failli échouer dans la tentative de coup d'État contre le Conseil des Cinq-Cents. Les députés turbulents ont traité Napoléon de « hors-la-loi », de « parvenu avide de pouvoir » et l’ont agressé. Enfin il n’a pu réussir, avec l'aide de son frère Lucien et de soldats armés de baïonnettes, que par un coup d'État sans effusion de sang. Napoléon devient Premier Consul de France.
Le Napoléon de Scott avance à grands pas à travers le reste des principaux événements de la vie de son héros. En 1804, il se couronne empereur, un acte qui a rendu furieux Ludwig van Beethoven, dont la Symphonie n° 3 (« Héroïque ») était à l’origine dédiée à Napoléon.
Au cours de la décennie de guerre suivante, le film donne un aperçu de diverses batailles, dont la célèbre victoire française sur les Autrichiens et les Russes à Austerlitz (1805).
Enfin, on assiste à la décision fatidique de Bonaparte d'envahir la Russie et ses conséquences. La bataille de Borodino (1812), une victoire à la Pyrrhus pour Napoléon où son armée subit des pertes colossales, est suivie de l'occupation de Moscou par les forces françaises. Les Russes abandonnent en grande partie la ville et l'incendient, privant les forces de Napoléon, loin de chez elles, de nourriture et d'autres approvisionnements.
Sans surprise, le quasi-dénouement du film se déroule à Waterloo en 1815, où les troupes françaises sont vaincues par deux armées, dont une force britannique commandée par le duc de Wellington (Rupert Everett). Napoléon est envoyé dans un second exil beaucoup plus sévère, à Sainte-Hélène, où il passe ses derniers jours.
Dans l'ensemble, le film de Scott n’apprend rien au spectateur qui s’intéresse à l’histoire. Il n'apporte que peu d'informations, hormis les plus superficielles, sur Napoléon en tant que personnalité et personnage historique, ou sur la Révolution française - y compris ses sources intellectuelles radicales dans le mouvement des Lumières - et ses conséquences.
L'œuvre consacre une grande partie de son temps à la relation entre Napoléon et Joséphine, à leurs problèmes sexuels et à leurs jalousies, ainsi qu'à l'absence d'enfants (et à la séparation du couple qui en résulte), sans grand effet. L'accent semble forcé, en partie motivée par les politiques contemporaines en matière de genre. Joséphine est obligée par cette dernière d'être une force décisive dans la vie et la carrière de Napoléon. Ce Napoléon laisse même entendre, assez bêtement, que l'invasion de la Russie par Bonaparte a été motivée en partie par sa jalousie à l'égard du flirt de son ancienne femme avec le jeune tsar Alexandre Ier (Edouard Philipponnat).
Le jeu des acteurs en général est acceptable, bien que Phoenix peine à essayer d'incarner une personnalité supérieure. Les limites de sa performance sont celles du scénario et de la mise en scène. Il traite le personnage comme un solitaire désespéré et un arriviste, quelqu'un qui essaie de faire ses preuves auprès des échelons supérieurs européens, balbutiant et marmonnant, dans un style « La Méthode » peu convaincant, pour se frayer un chemin.
Comme indiqué, le film passe rapidement sur de nombreux événements, ce qui ne permet guère au spectateur de les enregistrer ou de réfléchir à leur importance. Les éléments techniques, la cinématographie et le spectacle sont tous impressionnants, mais ils n'ajoutent pas grand-chose aux connaissances du spectateur.
Scott admire sans doute le génie militaire indiscutable de Napoléon mais il prenait racine en grande partie dans les transformations sociales déclenchées par la révolution de 1789, qui ne fait l'objet d'aucune discussion. Frederick Engels a observé que « la science de la guerre créée par la révolution et Napoléon était le résultat nécessaire des nouvelles relations engendrées par la révolution ». Les deux caractéristiques des « magnifiques découvertes » de Napoléon, la guerre de masse et la mobilité, présupposent « le degré de civilisation de l'époque bourgeoise ».
En fin de compte, nous comprenons que Scott considère la Révolution française et l'ensemble de l'époque ne sont guère plus plus que de erreurs colossales ayant entraîné des millions de morts. Napoléon se termine par une longue liste de morts dans les différents conflits qui ont suivi 1789. L'histoire, selon cette conception philistine, n'est qu'une succession de choses inutiles.
L'époque napoléonienne a fait l'objet d'une littérature et d'un art sérieux dans le passé. Certains des romans les plus remarquables du XIXe siècle représentent cette période, notamment La Chartreuse de Parme de Stendhal, La Foire aux vanités de Thackeray et Les Misérables de Hugo, qui traitent tous de la bataille de Waterloo, et, bien sûr, le monumental Guerre et Paix de Tolstoï, qui raconte l'invasion de la Russie par Napoléon. Toutes ces œuvres, et bien d'autres encore, ont tenté de donner un sens aux événements par rapport à la société européenne existante et à sa dynamique.
Ridley Scott n'a jamais démontré un tel intérêt ou une telle capacité (Alien, Blade Runner, Gladiator, etc.), et ne le fait pas ici. On soupçonne même Scott d'être inquiet face à la perspective d'une révolution aujourd'hui, même si un tel événement pourrait se justifier en réponse à une misère sociale généralisée.
En outre, Scott, qui privilégie le spectacle au détriment de la substance dans ses films, adopte une attitude nettement cavalière en réponse aux critiques sur les inexactitudes du film. Scott a commenté : « Lorsque j'ai des problèmes avec des historiens, je leur demande : 'Excusez-moi, mon pote, étiez-vous là ? Non ? Alors, taisez-vous' ». Les libertés artistiques sont inévitables, mais elles doivent correspondre de manière importante et constructive à l'esprit et à la substance du contenu examiné. Malheureusement, Scott n'est pas à la hauteur.
Le réalisateur français Abel Gance a créé en 1927 sa célèbre épopée muette de 330 minutes, Napoléon.
Stanley Kubrick avait l'intention de s'attaquer à la vie de Napoléon et a effectué des recherches approfondies. Il n'a pas pu réaliser le film, préférant mettre en scène Barry Lyndon (1975), dont l'action se déroule en partie pendant la guerre de Sept Ans. Le projet de Kubrick a apparemment été repris par Steven Spielberg sous la forme d'une série télévisée HBO. Waterloo (1970) de Sergei Bondarchuk, avec Rod Steiger dans le rôle de Napoléon et Christopher Plummer dans celui de Wellington, avec une brève apparition d'Orson Welles dans le rôle de Louis XVIII mérite également d'être mentionné.
Le rôle historique de Napoléon Bonaparte est depuis longtemps soumis à l'analyse marxiste, qui en a démêlé les contradictions, à la fois comme figure de la réaction par rapport aux impulsions radicales et égalitaires de la Révolution française, et comme abomination « jacobine » terrifiante pour l'Europe féodale et la classe dirigeante britannique.
La Révolution française, affirmait Engels, était la victoire « des grandes masses de la nation, travaillant dans la production et dans le commerce, sur les classes privilégiées oisives, les nobles et les prêtres ». Mais ce triomphe « s’est vite révélé exclusivement comme la victoire d’une plus petite partie de cet ‘état’, comme la conquête du pouvoir politique par la section socialement privilégiée de celui-ci, c’est-à-dire la bourgeoisie possédante ».
Bonaparte, a écrit Trotsky, arrêta la révolution « au moyen d'une dictature militaire. Toutefois, lorsque les troupes françaises envahirent la Pologne, Napoléon signa un décret stipulant : 'Le servage est aboli'. Cette mesure n'était dictée ni par les sympathies de Napoléon pour les paysans, ni par des principes démocratiques, mais par le fait que la dictature bonapartiste s'appuyait sur les rapports de propriété bourgeois et non féodaux ».
Trotsky a souligné ailleurs que « Robespierre cherchait son soutien parmi les artisans, le Directoire parmi la bourgeoisie moyenne. Bonaparte s'est allié aux banques. Tous ces changements - qui avaient, bien sûr, une signification non seulement politique mais aussi sociale - se sont produits, cependant, sur la base de la nouvelle société et du nouvel État bourgeois ».
Il s'agit d'analyses complexes, mais ni ésotériques ni inaccessibles. L'artiste qui commence par fermer délibérément les yeux sur les études et recherches historiques sérieuses, qui décide de travailler à l’aveuglette lorsqu’il s'attaque à des événements historiques, a peu de chances d'aboutir à une œuvre convaincante ou durable. Le Napoléon de Scott en est un exemple.
(Article paru en anglais le 12 janvier 2024)