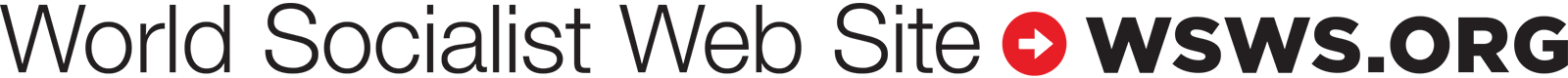Dix des 36 États du Nigéria ont annoncé un couvre-feu de 24 heures, alors que l'État du Lagos, qui abrite le centre commercial du pays, Lagos, avec une population de 20 millions d'habitants, a annoncé un couvre-feu illimité.
C'est l'une des nombreuses mesures employées par l'État pour tenter d'arrêter le mouvement croissant contre la brutalité policière. Les manifestations font rage dans tout le pays contre le gouvernement du président Muhammadu Buhari depuis près de trois semaines.
Des groupes de jeunes hommes brandissant des machettes, des gourdins et des armes, généralement considérés avoir été déployés par le gouvernement, ont attaqué les manifestants #EndSARS (abolir la police d’élite), y compris dans la capitale, Abuja. Selon certaines informations, certains prisonniers ont été libérés de prison pour attaquer les manifestants et les biens, terrorisant les habitants de Lagos. Ces forces ont traditionnellement été utilisées comme des auxiliaires de la police et de l’armée, comme moyen pour ces derniers de nier toute responsabilité des actes commis.
Mercredi, le gouvernement a déployé une police antiémeute dans tout le pays pour mettre fin aux troubles, et de nombreux cas de coups de feu ont été rapportés.
Ces mesures font suite au déploiement par le gouvernement de soldats pour tirer sur des manifestants pacifiques bloquant le péage du pont Lekki- Ikoye à Lagos, mardi. Au moins 12 personnes ont été tuées, dont deux près du bâtiment administratif de l'État à Alhausa. La BBC a rapporté plus de 20 morts et plus de 50 blessés. Les manifestants s'étaient assis sur la route, agitant le drapeau nigérian et chantant l'hymne national.
Le déploiement de l'armée du Nigéria, qui a été à plusieurs reprises accusée d'atteintes aux droits humains, a fait suite à l'annonce la semaine dernière qu'elle était prête à faire respecter l'ordre et à s’occuper de manière radicale de toute situation créée par «des éléments subversifs et des fauteurs de troubles». Les autorités ont initialement nié qu'il y ait eu des morts, tandis que l'armée a dénoncé les informations faisant état de soldats tirant sur des manifestants comme de fausses nouvelles, ce qui a encore alimenté le tollé général.
Le lendemain, il y a eu une vague d'attaques contre des postes de police et des bâtiments publics à travers Lagos, y compris plusieurs banques, des bâtiments gouvernementaux, le palais Oba – qui abrite le souverain traditionnel de la ville – le péage Lekki et le siège d'une chaîne d'information télévisée. La station d'information appartient à une société liée à Bola Tinubu, un ancien gouverneur de Lagos qu’on estime avoir des ambitions présidentielles. La famille Tinubu serait propriétaire du péage Lekki, qui aurait perdu des centaines de milliers de dollars depuis le début des sit-in. Des jeunes ont encerclé l'enceinte du domaine de Tinubu sur Bourdillon Road dans le riche quartier d'Ikoyi.
Jeudi, un journaliste de la BBC a rapporté avoir entendu des coups de feu dans le quartier de Surulere à Lagos et vu des pneus brûler, tandis qu'un autre journaliste a posté une vidéo d'un centre commercial en feu dans la banlieue chic de Lekki, à quelques kilomètres du site du massacre de mardi.
Les manifestations dans le pays le plus peuplé d'Afrique ont commencé début octobre après le meurtre d'un jeune homme par la force de police spéciale anti-vol (SARS), une unité d'élite connue pour ses enlèvements, extorsions, tortures et meurtres. Un rapport récent d'Amnistie internationale a documenté 82 violations présumées des droits humains par la SARS à travers le pays au cours des trois dernières années, y compris des pendaisons, des simulations d'exécution, des agressions et la simulation de noyade, et a conclu que l'unité opère en toute impunité. La plupart des victimes étaient des jeunes âgés de 18 à 35 ans.
Les manifestants, en grande partie pacifiques, sont pour la plupart jeunes. Ils viennent de toutes les couches de la société, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur groupe tribal ou de leur religion. Des manifestations ont également eu lieu dans le nord du pays, à prédominance musulmane. Celles-ci témoignent de la nature de classe de l'oppression à laquelle ils sont confrontés aux mains de la police, dont la tâche est de protéger la propriété privée des moyens de production, y compris les ressources pétrolières du pays et les richesses de l'élite dirigeante.
Les principaux partis politiques n'ont joué aucun rôle dans les manifestations. Cela vaut aussi pour les syndicats du pays qui sont vilipendés pour leur étroite collaboration avec le gouvernement et leur trahison du mouvement de masse de 2012 et de la grève générale nationale contre la réduction des subventions aux carburants par le président Goodluck Jonathan et l'augmentation des tarifs de l'électricité. Le Congrès national syndical n'a pas appuyé une seule manifestation depuis l'arrivée au pouvoir de Buhari en 2015.
Au fur et à mesure que les manifestations s'intensifiaient, les manifestants ont été confrontés à des répressions de plus en plus violentes de la part des forces de sécurité qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles réelles, tuant au moins 10 personnes. Des dizaines d'autres ont été arrêtés et sont toujours en détention.
Le 12 octobre, Buhari s'est engagé à dissoudre la SARS détestée et à mettre en œuvre des «réformes de la police». Sa répétition de plusieurs promesses précédentes a été largement considérée avec scepticisme. Selon World Security et Police Index de l’Association internationale de science politique (International Political Science Association), le Nigéria possède la pire force de police au monde.
Le remplacement de la SARS par une nouvelle unité, les armes et tactiques spéciales (SWAT) n'a fait qu'exacerber les manifestations. SWAT est le nom des escadrons de la mort de la police paramilitaire aux États-Unis, un pays connu pour la brutalité policière et les meurtres par la police. Dans le nord du pays, principalement musulman, les gouverneurs des États se sont opposés à la dissolution de la SARS.
Alors que les vidéos circulaient dans le monde entier sur les réseaux sociaux, les manifestations ont suscité le soutien de personnalités sportives, de musiciens, d'écrivains, de célébrités et d'autres personnalités, tandis que les communautés de la diaspora nigériane se sont rassemblées en sympathie à Atlanta, Berlin, Londres et New York. Mercredi, des centaines de personnes ont manifesté devant le haut-commissariat du Nigéria à Londres, qui compte environ 250.000 personnes d'origine nigériane. Plus de 210.000 personnes ont signé une pétition appelant le Royaume-Uni à sanctionner les membres du gouvernement et des forces de police nigérianes pour violations des droits humains commises contre le mouvement #EndSARS. Les pétitions doivent être examinées par le parlement une fois qu'elles atteignent 100.000 signatures.
En revanche, la réponse des dirigeants africains et des puissances impérialistes a été de garder le silence ou de publier des déclarations pour la forme exhortant Buhari à respecter le droit de manifester pacifiquement, condamnant la violence et appelant les autorités nigérianes à enquêter sur les meurtres.
Loin de rentrer dans les rangs, les manifestants ont élargi leurs revendications. Ils ont appelé à la libération immédiate de tous les manifestants, à la justice pour toutes les victimes décédées de brutalités policières avec une indemnisation appropriée pour leurs familles, à la création d'un organe indépendant chargé de superviser l'enquête et à la poursuite de tous les rapports d'inconduite policière, à une formation de tous les agents de police de la SARS dissoute avant leur redéploiement et une augmentation du salaire de la police prôné par le hashtag # 5for5.
Les manifestations sont alimentées par une colère généralisée face à la pauvreté, aux inégalités et au chômage de masse. Environ 102 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, vivent dans la pauvreté – une augmentation de 10 pour cent suite à la pandémie et à l'effondrement de la demande et du prix du pétrole. Le taux officiel de chômage des jeunes dans un pays où la moitié de la population a moins de 19 ans est maintenant de 35 pour cent et de nombreux diplômés sont incapables de trouver du travail et sont contraints d’émigrer à l'étranger. Les Nigérians, principalement jeunes et d’origine ouvrière, qui manifestent réclament la fin de décennies de corruption et de mauvaise gestion, les hashtags #EndBadGovernance, #BetterNigeria et #FixNigeriaNow étant largement utilisés.
Certains appellent à la démission de Buhari, âgé de 77 ans, l'ancien général et chef d'État militaire de 1983 à 1985. Buhari a initialement pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Élu en 2015 et réélu l'année dernière, il a été soutenu par Washington dans le cadre de la volonté de l'impérialisme américain de consolider sa domination militaire et politique sur l'Afrique. Son prédécesseur, le président Goodluck Jonathan, eut de plus en plus maille à partir avec les États-Unis, en partie à cause de ses mesures visant à ouvrir l'industrie pétrolière et gazière du Nigéria aux investissements chinois.
Buhari a agi rapidement pour mettre en œuvre des mesures qui signalaient sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis, de militariser le Nigéria sous prétexte de combattre Boko Haram et d'autres groupes islamistes opérant dans le nord-est du Nigéria et la région du lac Tchad, et de réaffirmer le contrôle de ses ressources énergétiques. La brutalité des forces armées n'a fait que renforcer une insurrection croissante contre le gouvernement fédéral à Abuja.
Buhari lui-même est resté presque invisible pendant la crise, espérant apparemment que les manifestations s'éteindraient. Il est finalement apparu brièvement à la télévision jeudi soir pour appeler les manifestants à cesser de manifester et à se concerter avec le gouvernement. En tant qu'ancien général qui a pris et perdu le pouvoir lors de coups d'État militaires, il a également un œil sur l'armée.
Le colonel Sagir Musa, porte-parole de l'armée, qui intervient depuis longtemps dans les affaires politiques du Nigéria, s'est déclaré prêt à intervenir pour soutenir le « gouvernement démocratique». Cela a donné lieu à des soupçons selon lesquels il y avait une faction au sein de l'armée et du Département de la sécurité d'État avec sa propre feuille de route. Le chef d'état-major de l'armée, le général Tukur Yusuf Buratai, est resté silencieux alors que la crise s'intensifiait, alors même que l'armée intervenait.
La fin de la brutalité policière et la lutte contre la menace d'une autre dictature militaire nécessitent une lutte internationale contre le capitalisme. Cette lutte ne peut être menée avec succès que par une classe ouvrière unifiée peu importe la race, l’ethnie ou la religion et au-delà des frontières nationales dans une lutte pour le socialisme.